Covid-19 : le centre de vaccination de l'hôtel de ville deMontpellier rouvrira ses portes le 6 décembre pour lutter contre la 5eme vague de covid
« La 5ème vague est une nouvelle épreuve. La situation sanitaire est préoccupante sur la ville de Montpellier et les services hospitaliers voient leur fréquentation augmenter. En conséquence, j’ai décidé de rouvrir le centre de vaccination municipal pour accompagner la dose de rappel vaccinal. La salle Pagézy restera également ouverte pour se faire tester, au moindre symptôme, avec des horaires renforcés. J’appelle tout le monde à respecter scrupuleusement les gestes barrières. La mobilisation est générale, de la part de tous les partenaires du système de santé, pour reprendre une vigilance qui s’était relâchée au cours des dernières semaines. »
Michaël DELAFOSSE, Maire de la Ville de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Le centre de vaccination rouvrira ses portes lundi 6 décembre 2021, avec une capacité de plus de 1 000 injections par jour, destinée à répondre à la forte demande.
Le centre sera ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h. Les créneaux seront ouverts dans les jours prochains et réservables sur la plateforme https://www.doctolib.fr/
Cette réouverture est permise par la mobilisation de tous les partenaires du centre, le SDIS 34 et le Département de l'Hérault, la Croix-Rouge Française et Secours infirmiers, sous l'égide de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Renforcer la vigilance face à la reprise épidémique
La forte reprise épidémique observée dans le Département de l'Hérault et à l'échelon national appelle à un renforcement de la vigilance et des gestes barrières. La ville de Montpellier appelle au respect des recommandations sanitaires annoncées au niveau national, particulièrement le port du masque.
Compte-tenu de cette évolution sanitaire, la Ville de Montpellier a pris la décision d’annuler le repas de l'Age d'Or prévu début janvier 2022. La protection de nos aînés est la priorité ; ce temps chaleureux sera remplacé par d’autres formes de convivialité et de solidarité.
Contre le covid 19, la vaccination demeure la seule arme pour freiner la reprise épidémique et éviter les formes les plus graves de la maladie. L’accès à la dose de rappel va dans le sens d’une meilleure protection collective face à l’épidémie, les pouvoirs publics recommandent fortement à tous les publics éligibles d’accomplir cette démarche.
Comment prendre rendez-vous ?
Les usagers pourront prendre rendez-vous :
- Via doctolib
- Par téléphone : 0 809 54 19 19
IMPORTANT : Seules les personnes ayant pris un rendez-vous seront prises en charge. Il est inutile de venir en avance et il est demandé aux patients de se présenter à l'heure du rendez-vous afin de ne pas créer une file d'attente trop importante et de veiller aux mesures de distanciation.
A leur arrivée, les personnes suivent la signalétique les orientant vers le Centre de Vaccination et la Salle des Rencontres. Elles sont ensuite invitées à remplir le questionnaire médical nécessaire et enfin se faire vacciner. Comme le prévoit le protocole de vaccination, les patients seront au repos et surveillés médicalement durant 15 minutes après leur injection.
Accès
La localisation du centre de vaccination au sein de l'Hôtel de Ville de Montpellier permet une facilité d'accès pour tous les publics.
- Tramway, L1 et L3, arrêt Moularès - Hôtel de Ville ;
- Tramway, L4, arrêt Georges Frêche - Hôtel de Ville ;
- Voiture, parking Hôtel de Ville.














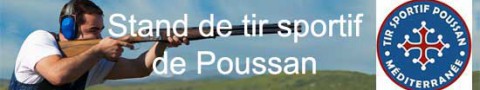

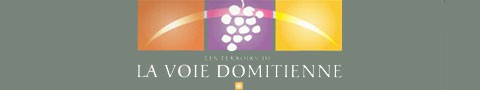
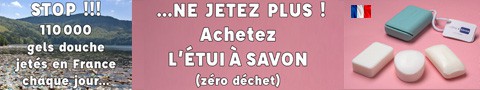

 D'ailleurs, une brasserie, au carrefour du boulevard et de la place Chaptal, porte une enseigne dédiée "aux finances".
D'ailleurs, une brasserie, au carrefour du boulevard et de la place Chaptal, porte une enseigne dédiée "aux finances".  Augustin Charles Daviler, architecte de la province du Languedoc (Paris 1653-Montpellier 1701)
Augustin Charles Daviler, architecte de la province du Languedoc (Paris 1653-Montpellier 1701)